The Ocean Race: Étape de l'océan Austral - tous des mauviettes aujourd'hui ou quoi ?
YACHT-Redaktion
· 25.02.2023
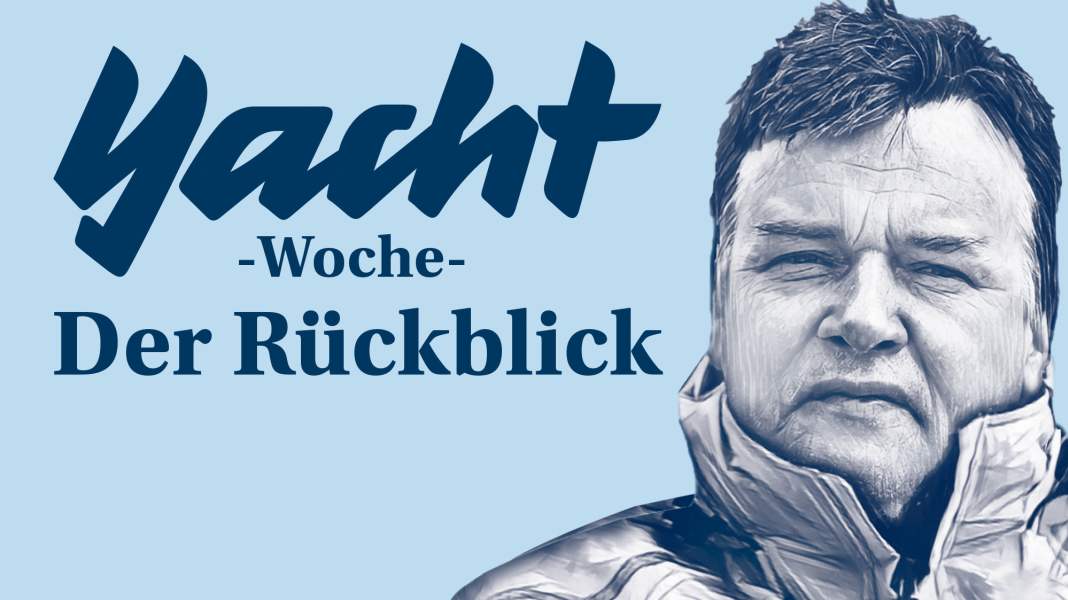

Chers lecteurs, chères lectrices,
La troisième étape de The Ocean Race, qui relie Le Cap à Itajaí au Brésil, débute ce week-end. Avec près de 13 000 miles nautiques, il s'agit du tronçon le plus long et le plus difficile. Pour la première fois dans l'histoire de la course, qui a débuté en 1973 sous le nom de Whitbread Round the World Race, elle passe en une seule fois devant les trois grands caps. Le chemin le plus court longe la glace de l'Antarctique. Pour des raisons de sécurité, le comité de course définit donc une limite virtuelle de glace à ne pas franchir.
Des températures de l'eau à un seul chiffre, un temps souvent gris et maussade et surtout des dépressions se déplaçant d'ouest en est déterminent le quotidien à bord tout comme la navigation. Les équipages s'efforcent d'attraper la dépression sur son front et d'y suivre la vague de vent, de foncer le plus longtemps possible avec le vent fort ou la tempête, ce qui fonctionne longtemps grâce aux vitesses élevées des Imocas, jusqu'à 30 nœuds, et permet ainsi des performances extrêmes sur 24 heures. Il est souvent possible d'atteindre plus de 500 miles nautiques. Le record pour les yachts de 60 pieds est actuellement de 558 miles nautiques en 24 heures.
Ce ne sont pas les 500 miles nautiques en plus, mais l'étape et la zone maritime qui me rappellent des souvenirs. En 1989/90, j'ai participé à la "Clé de Brême" allemande, le projet de la très dynamique association de voile Das Wappen von Bremen, qui avait sauté les obstacles logistiques et financiers d'une course mondiale et organisé la participation avec des équipages et des skippers différents. Un acte herculéen pour une association.
La plus longue étape de cette 5e édition de la course s'est déroulée de Punta del Este en Uruguay à Fremantle en Australie en passant par l'océan Austral, l'Atlantique Sud et le sud de l'océan Indien en une seule fois, soit 7 260 milles nautiques de route directe. Il nous a fallu 36 jours. C'était très dur, par moments. Il n'y avait pas de portes des glaces, chaque bateau pouvait aller aussi loin au sud que le skipper le jugeait bon. Le facteur limitant, outre la glace réelle, était le risque d'attraper une dépression par le fond, ce qui aurait signifié un vent contraire. Nous avons donc découvert l'océan Austral dans toute sa splendeur : des icebergs dans toute leur splendeur, des growlers dangereux parce que peu visibles, une navigation endiablée dans le brouillard, un homme de quart relégué au rôle de vigie. Une manœuvre d'homme à la mer pendant la nuit s'est bien passée pour nous. Dans la flotte, six personnes sont passées par-dessus bord pendant l'étape, toutes ont pu être ramenées à bord, mais sur le "Creighton's Naturally" anglais, le désastre a rencontré la malchance. Lors d'un empannage, un pataras s'est brisé, le bateau s'est à nouveau affalé, les deux colonnes de grinder ont été arrachées du pont. Deux jeunes marins ont été débarqués. L'un d'eux est décédé après le sauvetage. Anthony Phillips a ensuite été enterré en mer.
Les jambes, les bras, les bômes et les tangons se sont brisés, les voiles, les écoutes et les cloisons se sont déchirées. Les manœuvres étaient aussi compliquées, coûteuses et sources d'erreurs (c'était génial !) qu'à l'époque où l'on changeait encore le spi dans l'empannage et où il fallait aussi faire glisser le blooper, où il existait des ensembles tack-gybe dans lesquels la bôme de spi se trouvait sous le vent du génois pendant une partie de la manœuvre, ou des manœuvres de récupération complexes pour le spi appelées Kaiser ou Kiwi Drop. Quand on changeait les voiles l'une dans l'autre sur un étai.
Vu d'aujourd'hui, le bateau était une horreur pour son utilisation : une construction unique de 63 pieds de Baltic Yachts, l'ancien "SiSiSi". Plutôt lourd, car construit dès 1983 comme bateau de semi-croisière et richement équipé de la technique des années quatre-vingt. Cela signifiait : des écoutes en fil de fer qui faisaient parfois des étincelles sur les tambours de treuil et dont les carènes cassées s'enfonçaient dans ces derniers sous forme de crochets à viande. Les fils devaient être vissés sur les cornes d'écoute, avec la clé de 19 sur le pont avant. Des tuyaux hydrauliques qui éclatent, de l'huile synthétique qui se déverse dans une couchette et qui brûle particulièrement les plaies. Le bateau était un gréement haut de gamme, 22 voiles à bord, huit spis flottant librement sur la bôme jusqu'au spi de tempête à 60 % avec des cordes en Dyneema dans les amarres. Et dans le plus pur style du COI, le bateau ne naviguait bien sûr pas comme sur des rails, mais jouait volontiers du violon face au vent.
Et puis les vêtements. Musto était sérieusement le seul choix à l'époque, sur le "Flyer" hollandais victorieux, ils avaient participé au développement des détails. De bonnes choses pour les conditions de l'époque. Il n'empêche : tu transpirais et tu gelais non seulement comme un porc, mais aussi en même temps, tu étais en fait sec, mais quand même mouillé sur la peau. La respirabilité n'existait pas encore. L'eau était à zéro, la température sous le pont était à un seul chiffre, il n'y avait pas de chauffage. Et ceux qui étaient mouillés gardaient leurs vêtements dans le sac de couchage, on appelait ça dormir au sec. Le froid avait un bon côté : les odeurs étaient sans doute encore acceptables.
Mais : nous avons vécu de longues vagues merveilleusement réglables et utilisables pour le surf, des embruns sur une eau verdâtre, des nuits interminables dans l'obscurité totale ou sous un ciel étoilé incroyablement magnifique, la joie de partir, de s'habituer à la vie quotidienne à bord et à la longue distance, l'arrivée. La satisfaction de guider un bateau de 21 tonnes à travers les vagues, de lui faire atteindre des vitesses de plus de 20 nœuds avec un spi de tempête et une grand-voile gonflée. On n'oubliera pas non plus la vue des orques (bon, les marins d'aujourd'hui les voient différemment...), des pétrels ou des albatros qui naviguaient à hauteur des yeux, juste derrière le bateau. Et puis il y a les icebergs dans leur beauté variée de formes, de couleurs et de lumière. Tout cela valait bien le moindre désagrément.
Et aujourd'hui ? Ils ne verront pas de glace, à cause desdites limites. Et les cockpits entièrement couverts les protègent de l'eau. Une bonne chose : les navigateurs restent au sec et en forme, ils ont une meilleure vue d'ensemble, l'eau a moins de chance de pénétrer dans le bateau, le cockpit reste libre des masses d'eau. Et la structure, grâce à sa flottabilité, aide le bateau à se redresser plus rapidement en cas de chavirage, ce qu'il doit prouver lors du test de chavirage. Plus de volume dans le rouf signifie donc aussi moins de poids sur la quille, une circonstance qui contribue à la cabane prononcée sur le bateau de Boris Herrmann "Malizia - -". Seaexplorer". Et si les navigateurs doivent tout de même quitter l'abri, ils peuvent se réjouir de disposer d'un ciré optimal, super respirant, chaud et sec. Ils manipulent des cordages agréables et performants, le fil de fer n'existe plus. Et les manœuvres sont moins complexes : les voiles de différentes tailles et de différents profils sont enroulées et déroulées, puis posées et récupérées sous forme de boudin de toile enroulé.
La longue étape à travers les régions polaires australes est-elle passée de la zone de combat à la zone de confort ? Non ! Les navigateurs sont sollicités comme jamais auparavant. La vitesse des bateaux et leurs mouvements sont brutaux, tout comme les secousses, les accélérations et les ralentissements qui peuvent faire tomber les navigateurs à la renverse. Ou comme le raconte Jack Bouttell de 11th Hour Racing : "Passer d'un côté à l'autre du bateau peut prendre une minute. Il faut prendre appui et attendre le bon moment pour passer à l'étape suivante".
Un autre sujet qui va à l'encontre du physique humain est le sifflement assourdissant des foils, qui augmente avec la vitesse et qui malmène l'oreille et le cerveau. Les acouphènes hydrodynamiques ne peuvent être atténués que par la technologie de réduction du bruit dans les écouteurs high-tech. Aux mouvements et au bruit s'ajoute le souci de rencontrer un OVNI, un objet flottant non identifié, en vol à l'aveugle à 30 nœuds, et ce parfois de nuit ou dans le brouillard. Le système Oscar, assisté par l'IA et équipé de caméras thermiques et nocturnes, est censé y remédier, mais il n'a pas encore été fortement testé et éprouvé.
Non, ce n'est certainement pas plus facile pour les équipages aujourd'hui, et rien n'était mieux avant, juste différent. Une chose restera sans doute : On dit que personne ne sort de l'Océan Austral sans avoir été transformé par l'expérience. Dans mon cas, c'était le désir d'y retourner. Ce qui, je l'espère, se produira encore...
Fridtjof Gunkel, rédacteur en chef adjoint de YACHT
Newsletter: YACHT-Woche
Der Yacht Newsletter fasst die wichtigsten Themen der Woche zusammen, alle Top-Themen kompakt und direkt in deiner Mail-Box. Einfach anmelden:
Cliquer pour parcourir
La semaine en images :






Recommandations de lecture de la rédaction :

LA RACE DE L'OCEAN
Un jour avant le départ de la troisième étape- 12 750 miles nautiques à parcourir

Après l'In-Port Race d'hier, les cinq équipes Imoca effectuent aujourd'hui les derniers préparatifs avant le coup d'envoi de la troisième étape, prévu demain à 13h15. Avec une distance de près de 13 000 milles nautiques, c'est la plus longue étape de l'histoire de la course qui attend les navigateurs. Du Cap, ils passeront par les trois grands caps pour rejoindre Itajaí au Brésil.
PETIT CROISEUR "DOPAMINE"
Joli, abordable et aussi à construire soi-même

La construction en contreplaqué de la manufacture de bateaux de Lüneburg est proposée sous forme de plan, de coque ou prête à naviguer.
MADES DE LA MER
Les aventures des circumnavigateurs autrichiens

Doris Renoldner et Wolfgang Slanec, dit Wolf, mènent une vie entre patrie et lointain, entre vie à bord et vie à la campagne. Régulièrement, les aventuriers de la voile reviennent en Autriche pour donner des conférences qui financent leurs voyages.
"GERTRUD III"
Un classique qui a transformé des rats des champs en marins

L'achat occasionnel d'un croiseur de mer d'avant-guerre s'est transformé de manière inattendue en projet de restauration d'un classique pour trois débutants en voile. Ils ont sauvé un témoignage rare des yachts de croisière de cette époque.
VENDÉE GLOBE
Le sponsor de Crémer, la Banque Populaire, se retire

Les remous autour de Banque Populaire et Clarisse Crémer ne s'arrêtent pas. Au lieu de présenter un nouveau skipper, le sponsor a décidé de ne pas poursuivre la campagne pour le Vendée Globe 2024.
FOCUS 30
Une pour tous et pour tout

Un complément passionnant pour le marché des bateaux de tourisme compacts nous vient de Pologne. Le nouveau vaisseau amiral du chantier naval Sobusiak Yacht doit allier des caractéristiques de navigation sportives à une grande convivialité. Pour cela, le concept est extrêmement modulable
CHÉNEAU ENFONCÉ
"Eleonora" doit être démantelée

Pendant près de trois mois, l'"Eleonora" est restée au fond du port de Tarragone après avoir été éperonnée par un navire de ravitaillement. Après son sauvetage en automne, il a été décidé de démolir la goélette de 49 mètres de long.
SAARE 41.2
Un grand confort pour un petit équipage

Le chantier naval estonien a adapté un autre bateau aux besoins du nombre typique de personnes à bord
Newsletter: YACHT-Woche
Der Yacht Newsletter fasst die wichtigsten Themen der Woche zusammen, alle Top-Themen kompakt und direkt in deiner Mail-Box. Einfach anmelden:

