
Le naufrage d'autant de yachts dans le port, comme lors de la marée de tempête en mer Baltique, a nécessité plusieurs éléments. Le niveau d'eau élevé, combiné aux vagues qui ont traversé certains ports, a généré des pics de charge sur les amarres et les pontons, qui n'étaient souvent pas en mesure de les supporter. A cela s'est ajouté un vent violent.
L'exemple d'un yacht de 10 mètres montre ce que cela signifie lorsque beaucoup de vent souffle latéralement, surtout sur les yachts modernes.
Les yachts modernes ont d'énormes surfaces d'attaque
Au cours des dernières décennies, l'évolution de la construction s'est de plus en plus orientée vers des volumes au-dessus de la ligne de flottaison (voir galerie).



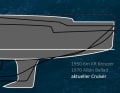

Si l'on imagine un quadrilatère autour de la surface projetée, ce quadrilatère est de plus en plus rempli par les yachts modernes. En raison de poupes et d'étraves droites, d'un franc-bord important et de superstructures hautes et longues.
Celles-ci offrent au vent d'énormes surfaces d'attaque. Dans des conditions modérées, on ne s'en rend généralement pas compte, car par vent faible, la pression du vent sur ces surfaces est plutôt faible. La pression sur la coque et le gréement augmente cependant au carré de la vitesse du vent. Ainsi, la différence entre trois forces de vent et neuf forces de vent ne représente pas un triplement de la pression du vent, mais presque 21 fois plus.
Pressions du vent sur une surface d'un mètre carré avec cw = 1
Les gréements offrent également une plus grande surface d'attaque
Un autre aspect s'ajoute à l'augmentation des surfaces projetées. Lors de la conception du gréement, les parts de surface de voile se déplacent de plus en plus en faveur de la grand-voile. Les mâts et les grandes bômes s'allongent. Supposons que le mât d'un yacht de dix mètres mesure environ 13 mètres de long. Avec une profondeur de profil de 25 centimètres, cela donne une surface projetée de 3,3 mètres carrés, ce qui correspond à peu près à une voile d'opti !
S'y ajoutent des enrouleurs de voile d'avant ; rares sont les voiliers de croisière qui y renoncent aujourd'hui. Pour une longueur de guindant d'environ douze mètres, le boudin de toile enroulé donne, avec un diamètre de seulement dix centimètres, ce qui serait peu, une surface projetée de 1,2 mètre carré. Ou les lazy-bags : longueur de bôme de 4,5 mètres, hauteur du sac d'environ 40 centimètres - soit 1,8 mètre carré. Ceux-ci, de surcroît, se trouvent à environ trois mètres au-dessus de la surface de l'eau, car les grands arbres sont accrochés plus haut qu'auparavant afin de permettre des sprayhoods spacieux.
En tout et pour tout, un bateau de croisière moyen de dix mètres offre plus de 20 mètres carrés de surface d'attaque au vent au-dessus de la ligne de flottaison, sans compter les étais, les haubans, les barres de flèche, les paniers d'étrave ou de poupe, la capote de descente ou même les taud de soleil. Cela correspond à 360 kilos à Beaufort 7, au repos, pas encore accéléré.
Or, ces presque 360 kilos ne doivent pas être entièrement retenus par les amarres, car premièrement, le vent ne vient pas toujours exactement du côté, et deuxièmement, toutes les surfaces de la projection ne sont pas verticales.
Pourtant, les chiffres montrent clairement les charges énormes que le vent peut générer à lui seul. En cas de tempête dans un port, chaque mètre carré qui peut être retiré du vent est décisif.
On ne sait pas exactement quelles charges sont générées lorsque non seulement le vent souffle en conséquence, mais que le yacht, qui pèse généralement plusieurs tonnes, s'enfonce dans les amarres avec sa masse accélérée par les vagues. Mais il est logique qu'elles puissent être plusieurs fois supérieures à celles causées par le seul vent.
Quelle est la résistance des amarres ?
Certaines pertes auraient certainement pu être évitées grâce à de meilleures amarres. Une vieille écoute ou un objet similaire est un très mauvais choix pour l'amarrage. De telles amarres, souvent vieilles et étirées, n'ont plus qu'une fraction de leur durée de vie.
Pour les amarres modernes, spécialement conçues à cet effet, trois facteurs sont décisifs : la charge de travail, la charge de rupture et le comportement à l'allongement. Notre test de cordage fournit des informations précises à ce sujet. Certes, les amarres de 14 millimètres d'épaisseur qui y sont testées ont une charge de rupture de plus de quatre tonnes pour un yacht de 10 mètres. Mais dans la pratique, la charge de rupture d'une amarre ne joue qu'un rôle indirect, c'est la charge de travail qui en est déduite. Selon les recommandations de la société de classification DNV GL, celle-ci ne devrait pas dépasser 20 % de la charge de rupture, ce qui correspond à des valeurs comprises entre 735 et 1 128 décanewtons pour les candidats au test. Des charges de travail plus élevées laissent une marge de manœuvre pour les dommages mécaniques du câble.
Et une fois qu'une amarre est endommagée, sa charge de rupture diminue de manière dramatique, parfois de moins de la moitié lors du test.
Plus il y a d'étirement, plus il y a d'énergie absorbée
Le comportement à l'allongement est également important. L'énergie qui passe dans le cordage pour l'allonger n'arrive pas à l'accastillage à bord ou sur le ponton. Sur ce point également, le cordage testé était très différent.
Ce que les amarres doivent pouvoir faire
- Allongement élevé : Plus la ligne peut absorber d'énergie en changeant de longueur, plus le bateau s'enfonce souplement, ce qui réduit la charge sur les taquets et rend le séjour à bord plus confortable.
- Charge de rupture élevée : La charge de rupture nécessaire dépend de la taille du bateau. Même de petites zones de frottement affaiblissent fortement le cordage, il faut donc prévoir une réserve.
- Robuste : Des anneaux de fer rouillés, des quais en béton ou les buses à lèvres avec des coutures en fonte : La liste des points de frottement possibles est longue. La houle et le vent font que les amarres sont pratiquement toujours en mouvement. Seules les constructions très robustes résistent à ce stress permanent.
- Lehnig : Plus la ligne est souple, plus il est facile de la garnir et de l'ouvrir.
Les nœuds affaiblissent les lignes
Il est bien connu que les nœuds réduisent la résistance des cordages, mais dans quelle mesure la charge de rupture diminue-t-elle ? Nous avons étudié les nœuds les plus courants pour relier deux lignes, avec un cordage de 10 millimètres. Dans le cas des cordages en polyester, l'âme et la gaine portent presque à parts égales. Il n'y a donc pas de problème à ce que ce soit principalement la gaine qui se contracte dans le nœud. Il en va différemment pour les dyneemaleins, qui tirent leur résistance presque exclusivement de l'âme très lisse. Si celui-ci glisse dans le nœud, une charge trop importante se déplace sur la gaine - et celle-ci se casse.
Par exemple, le nœud de chaise, souvent utilisé dans les amarres, réduit la charge de rupture de la ligne de 73% !
Ne pas économiser sur l'amarre
Le vent et les vagues peuvent donc aussi générer des charges énormes sur un yacht dans le port, charges qui doivent être absorbées par les amarres. Même les cordages modernes voient leur charge de rupture diminuer en raison de nœuds ou de points défectueux. Cependant, il n'est pas nécessaire d'additionner ces faiblesses, l'amarre se rompt toujours pour une seule de ces raisons : sous-dimensionné, présence de nœuds, présence de points défectueux. C'est pourquoi il faut tenir compte des points suivants pour les amarres :
- choisir une taille d'amarre supérieure à celle recommandée pour son propre yacht
- placer le plus grand nombre possible d'amarres à différents points d'ancrage afin de répartir les charges
- sur les poteaux : Assurer les amarres contre le glissement vers le haut du piquet à l'aide d'un œil traversant qui se pince lui-même.

