





L'ossature du pont est pratiquement identique du dériveur au yacht de haute mer classique. Parallèlement à l'arête supérieure du tablier (planche la plus haute), se trouve le balkweger, qui sert à recevoir les poutres du pont. La liaison entre les poutres de pont et le calepinage est généralement réalisée par une queue d'aronde, afin que les forces de traction puissent être absorbées de manière positive. En règle générale, les poutres de pont sont pourvues de la même membrure de l'avant à l'arrière. Ce n'est que dans les classes de mètres, en particulier dans les 12, que la baie de poutre varie dans la zone centrale pour des raisons de jauge.
Les poutres de pont sont interrompues pour le cockpit, les superstructures de cabine ou les écoutilles, les extrémités centrales reposant alors dans la boucle du cockpit, de la cabine ou de l'écoutille. Les poutres courtes qui vont de la boucle au chemin de poutres dans la zone des superstructures de cabine, des écoutilles ou du cockpit sont appelées "poutres de jonction" ou "demi-poutres". Les grands yachts sont en outre équipés de barres de traction métalliques (généralement en bronze) qui relient le balconnet à l'élingue afin de mieux absorber les forces de traction qui se produisent en mer.
Pour renforcer la liaison coque-pont, les poutres de pont et les membrures sont reliées entre elles par des coudes verticaux forgés. Les poutres de pont sont généralement fabriquées en chêne ou en frêne, voire en spruce pour les bateaux plus légers, tandis que les poutres de pont sont souvent en mélèze, en pin d'Oregon ou en pin.
Ponts en lin
L'un des types de revêtement les plus anciens et les plus classiques pour les toits de cabines et les ponts roulants est le lin. Les planches en bois de conifères légers comme l'épicéa, le pin ou le mélèze à feuilles fines, plus rarement le spruce, étaient clouées directement sur les poutres du pont à l'aide de rainures et de languettes, et l'étanchéité était assurée par le revêtement en lin.
La plupart des ponts en toile sont aujourd'hui vieillissants et ont tendance à se fissurer. Il n'est pas rare que les planches de pont sous-jacentes présentent des signes de pourriture. En particulier, les lattes de pont clouées avec du "fer noir" (non galvanisé) des toits de cabine en bois de conifères légers sont sujettes à des dégâts de corrosion dus à l'humidité.
Si, face à un processus de vieillissement avancé du pont en toile, on décide de le recouvrir d'une nouvelle toile, il faut d'abord remplacer les bois endommagés. Les instructions pour le remplacement du revêtement en lin se trouvent dans le chapitre sur les superstructures.

Ponts à barres classiques
Les ponts des yachts classiques haut de gamme sont généralement recouverts de teck. Pour les croiseurs de l'archipel ou les portes pointues nordiques, on utilisait également du Spruce, du mélèze à grain très fin ou de l'Oregon Pine. Dans le cas d'un pont à barres posé de manière classique, le pont de honte est parallèle à la ligne extérieure du pont. Les bois d'embrasure s'étendent autour de la structure de la cabine et des écoutilles. Le bordé central est constitué d'un "poisson" "plié" ou droit sur les côtés, dans lequel les planches de pont se rejoignent latéralement.
Les bois de corps forment, avec le pont de honte et le poisson, l'encadrement des planches de pont dont ils protègent les faces. Pour des raisons esthétiques, elles sont généralement fabriquées en acajou et vernies, tandis que le teck reste brut.
Des bois de conifères étaient souvent utilisés pour le pont à barres des navires de croisière en archipel ou des bateaux à haubans.
Les bois d'embrasure et le pont de honte sont découpés dans un madrier, donc courbés, tandis que les planches de pont sont courbées. Si la courbure de la ligne de pont extérieure est trop importante ou si l'on souhaite donner au bateau un caractère plus élancé, il est possible d'utiliser des planches plus courtes et moins courbées dans les bouchains du pont de coque. Sur les bateaux à moteur, les planches de pont sont en principe parallèles à la ligne médiane du bateau.
Les yachts de plus grande taille sont équipés d'un contre-bord sur le bord extérieur du pont de protection, qui se termine vers le haut par une baguette à crête, généralement en frêne ou acajou verni.
Alors que les bois de corps et le poisson sont vissés aux poutres du pont, les planches étaient souvent clouées de manière invisible. Pour ce faire, les clous étaient enfoncés alternativement dans la poutre de pont et dans la planche adjacente afin de relier les planches de pont entre elles. L'avantage de cette méthode est que les planches de pont sont fixées de manière invisible sur les poutres de pont. L'inconvénient, en revanche, devient clairement visible à un certain degré d'usure : les têtes de clous sortent peu à peu du pont.
Obtenir l'étanchéité des ponts en bois
Pour l'instant, les têtes peuvent être retirées et recouvertes d'une bonde, mais à long terme, la résistance globale du pont en souffrira et il faudra le remplacer. Dans le cas d'un pont greffé, il est possible de dévisser les vis (si elles sont en bronze) et d'abaisser les trous des bouchons pour pouvoir les revisser.
Afin d'obtenir l'étanchéité souhaitée, les ponts planifiés étaient calfatés et scellés avec de la colle marine. Aujourd'hui, cette tâche est largement prise en charge par des mastics de jointoiement à élasticité permanente. Lors de l'utilisation de ces produits "modernes" sur un yacht classique, il convient toutefois de déterminer tout d'abord si le pont planifié présente une tension suffisante ou, en cas de fuites, s'il faut procéder à un nouveau calfatage avant de procéder à un nouveau jointoiement. Avant de procéder à un nouveau chaulage ou à un nouveau scellement des joints du pont, il convient d'éliminer le mastic de jointoiement en caoutchouc endommagé.
Un pont directement posé sur les poutres de pont est plus sensible aux fuites qu'un pont posé sur du contreplaqué comme décrit ci-dessous. D'autre part, les fuites sont plus faciles à localiser sur un pont posé en barres classiques.
Ponts en staff sur contreplaqué
Au milieu des années 1960, on a commencé à poser une couche de contreplaqué sur les poutres de pont, puis un pont en barres moins épais. Ce type de pont en contreplaqué est plus résistant à la torsion qu'un pont "uniquement" en lattes et possède une étanchéité plus durable. Toutefois, si le collage du revêtement de pont sur le contreplaqué est défectueux ou trop ancien, de sorte que l'eau s'infiltre à travers le joint du pont ou que les barres se détachent du contreplaqué, le contreplaqué risque d'être sérieusement endommagé par la pourriture.
Une méthode permettant de détecter les décollements du revêtement du contreplaqué est le "test de tapotement", qui consiste à taper sur le pont avec un marteau en plastique. S'il y a des décollements, on peut les reconnaître au son nettement différent, "élastique", presque "claquant". Si des décollements sont constatés sur un pont en "teck sur contreplaqué", par exemple par des grincements, lors du "test de tapotement" ou par des zones sensiblement molles, il est urgent d'agir. La première chose à faire est de vérifier s'il y a de l'humidité entre le teck et le contreplaqué.
Coller les barres de pont individuelles avec de la résine époxy.
Pour ce faire, il est possible de percer un trou jusqu'au contreplaqué à l'aide d'une perceuse Forstner et de déterminer le taux d'humidité du contreplaqué à l'aide d'un humidimètre pour bois. Lorsque le contreplaqué est sec et en bon état, il est possible - si l'on ne souhaite pas retirer tout le pont - de recoller les lattes détachées avec de la résine époxy. Pour ce faire, on perce des trous de 5 mm de diamètre au milieu de chaque baguette et on injecte de la résine époxy non épaissie à l'aide de canules de taille appropriée. Les tiges recollées sont lestées avec des poids jusqu'au durcissement de la résine. Les trous peuvent ensuite être fermés avec un bouchon de 8 mm collé avec de la résine époxy.
Une autre façon de déterminer l'état du contreplaqué sous les barres de pont est d'observer la face inférieure du pont. Souvent, la pourriture du contreplaqué se manifeste par un décollement de la peinture et la formation de fissures dans le sens des fibres. Si le contreplaqué est imprégné d'humidité ou présente des signes de pourriture, il peut être partiellement remplacé. Pour ce faire, une partie importante du revêtement en teck doit toutefois être enlevée. Si des zones étendues sont atteintes, il n'y a pas d'autre solution que de remplacer l'ensemble du pont.
Réparation des joints sur les ponts
Il est fréquent d'observer que l'usure du pont en teck laisse apparaître des joints en relief entre les barres du pont. Cela n'est pas seulement un inconvénient visuel, mais le pont offre également une moins bonne tenue et il y a un risque que la pâte à joint se détache des flancs en raison des mouvements de l'équipage sur le pont.
Dans la mesure où les joints en eux-mêmes sont encore intacts et adhèrent aux flancs, un couteau de précision Mozart peut y remédier en coupant les joints au ras des barres de pont - une activité simple et à la portée de tous.
Si la pâte à joint existante est poreuse et non étanche, il faut d'abord créer des joints propres sur les planches de pont afin de pouvoir les remplacer. En outre, pour des raisons esthétiques, les joints ne doivent pas présenter de graves déchirures ou de lignes sinueuses. Il faut également s'efforcer d'obtenir une largeur de joint aussi continue et uniforme que possible.
Pour les joints, il faut travailler à la main
Pour ce travail de longue haleine et très minutieux, le Multimaster de précision avec griffe à joints ou une rainureuse à lamelles conviennent parfaitement. Les défonceuses sont déconseillées, car elles sont difficiles à "tenir en place".

Obtenir des joints propres est une entreprise laborieuse malgré l'utilisation d'outils mécaniques, mais on ne peut pas renoncer au travail manuel. Souvent, des outils faits maison, tels qu'une lime pliée et rectifiée pour devenir un grattoir à joints, ou un papier de verre placé autour d'une bande de tôle, sont des aides efficaces.
Lors de la rénovation d'un pont, il est souvent indispensable d'enlever les ferrures qui sont restées longtemps sur le pont et qui semblent avoir "poussé". Il n'est pas rare que le bois sous les ferrures présente déjà des signes de pourrissement ou du moins de décoloration. Dans ce cas, il est possible de poser des bondes afin d'éviter que la pourriture ne progresse.
Rénover les joints sans lubrifier
Une fois les travaux préparatoires terminés, les joints peuvent être remplis. Mais comment appliquer la pâte à joint dans les joints sans provoquer un "désastre graisseux" ou gaspiller trop de matériau ? S'il ne s'agit que de petites zones à jointoyer, une seringue à main avec une cartouche de 310 ml est suffisante. S'il s'agit de zones plus importantes ou d'un pont entier, les tuyaux de 600 ml, qui peuvent être mis en œuvre à l'aide d'un pistolet à batterie, sont avantageux tant du point de vue de la manipulation que du prix.
Le choix de la pâte à joint n'est pas simplifié par l'offre pléthorique sur le marché. (Un aperçu détaillé avec les avantages et les inconvénients se trouve dans le livre).
Entretien des ponts en teck
Alors que le spruce ou le mélèze, par exemple, doivent être protégés des intempéries par des vernis ou des huiles et peuvent donc devenir dangereusement glissants lorsque l'on marche dessus, le teck ne doit pas être protégé par un revêtement en raison de sa propre teneur en huiles. Pour l'entretien des ponts en teck, la règle est plutôt : "Moins, c'est plus". Un entretien trop intensif révèle la véritable qualité d'une terrasse en teck en ce qui concerne le choix du bois : Le veinage d'une planche de teck ne doit présenter que des "cernes de croissance verticaux", de sorte que la face supérieure soit uniformément striée. Les planches avec des cernes de croissance verticaux jusqu'à une inclinaison de 45° sont appelées "rifts". Les cernes horizontaux donnent sur la face supérieure un aspect fleuri avec des cernes très espacés. En "frottant" trop intensivement, même en travers du fil, les cernes larges et souples sont enlevés plus rapidement et plus profondément que les cernes étroits et durs, ce qui crée peu à peu un relief ondulé.
L'huilage des ponts en teck n'a pas fait ses preuves, à moins d'être toujours réhuilé.
Sous l'effet des rayons UV, le teck brut prend une belle couleur gris-argentée uniforme. Mais les micro-organismes, les algues, les moisissures et même la mousse dans les cas les plus négligés attaquent le teck non protégé, ce qui rend souvent le pont inesthétique. Pour éviter cela, les propriétaires de yachts utilisent souvent des produits toxiques tels que des algicides pour terrasse ou piscine. Ces produits peuvent être utiles pour éliminer les impuretés du bois. Mais ils ne sont guère bénéfiques pour les vernis, les toiles, l'accastillage - sans oublier les eaux.
Un entretien efficace pour les ponts en teck
Le produit Boracol 10 Y(huit) de la société lavTOX, particulièrement efficace, peut être utilisé sans problème. Avant d'appliquer ce produit, le pont doit être nettoyé à l'aide d'une éponge spéciale disponible dans le commerce spécialisé. Appliquer ensuite le produit liquide sur le pont sec à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un vaporisateur.
Au bout de quatre à six semaines environ, les taches noires du bois dues à l'eau de pluie et à l'eau de mer sont éliminées et le pont prend une teinte argentée uniforme. Un traitement au Boracol deux fois par an, au printemps et à l'automne, est suffisant. L'huilage des ponts en teck ne s'est pas révélé avantageux. D'une part, trop d'huile ne garantit plus la résistance au glissement souhaitée, d'autre part, trop peu d'huile érode différemment les différentes zones du pont et le pont apparaît taché - à moins d'appliquer de l'huile à plusieurs reprises.
Ponts en acajou massif
La plupart des dériveurs classiques ou des dériveurs tels que les pirates et les dériveurs H sont équipés de ponts en bois massif. Pour cela, on utilise généralement des bois légers comme le Gabon (okoumé) ou l'acajou khaya. Pour protéger le bois, ces ponts sont peints avec un vernis brillant, ce qui leur confère certes un aspect noble, mais les rend très glissants.
Le problème de ces bois de ponts minces mais larges est souvent la fissuration dans le sens des fibres. Dans ce cas, il est possible de sauver certaines choses en les moulant, puis en les décollant et en les vernissant à nouveau. Le vissage avec des bouchons pose également souvent des problèmes, car là aussi, le bois peut se fissurer ou les bouchons peuvent être repoussés par la corrosion des vis sous-jacentes et tomber.
De nos jours, ces ponts en placage sont collés, souvent par un procédé sous vide sans vissage. Certains constructeurs de dériveurs incorporent même une couche de carbone pour augmenter la résistance.
Texte : Uwe Baykowski
Entretien et maintenance de yachts classiques- le livre
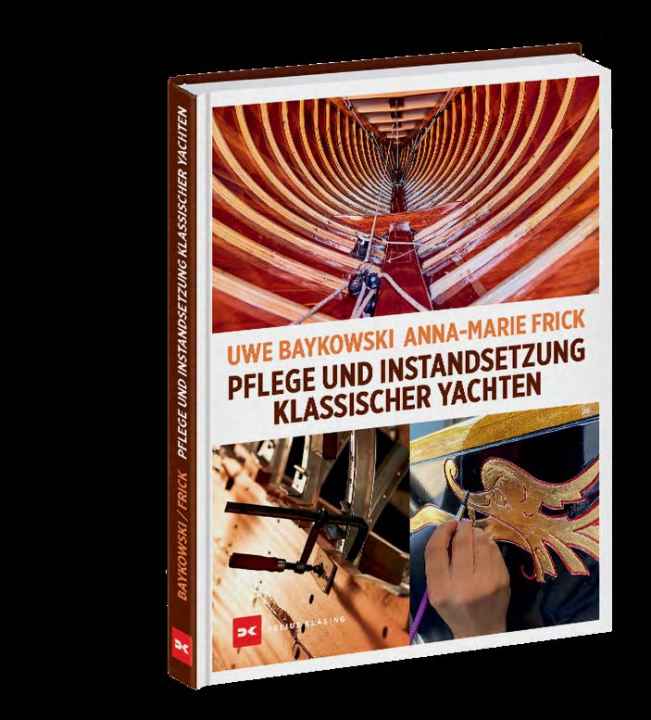
Dans son manuel d'entretien et de réparation, l'auteur a réuni toutes les connaissances qu'il a accumulées au cours de 50 années de travail dans la construction de bateaux en bois. Le lecteur y trouvera non seulement des instructions sur la manière d'entretenir correctement son bateau, mais aussi tout ce qu'il doit savoir pour reconnaître les dommages et pouvoir, le cas échéant, effectuer lui-même les petites et grandes réparations, voire la restauration complète.
Le livre coûte 39,90 euros et peut être commandé peut être commandé ici dans la boutique Delius Klasing !

