Les marsouins de la mer Baltique: "Nous devons résoudre le problème des filets maillants de fond !"
Andreas Fritsch
· 29.02.2024




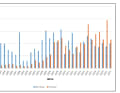
Dernièrement, le ministère de l'Environnement du Schleswig-Holstein a fait dresser l'oreille aux plaisanciers intéressés par l'environnement, car le ministre Goldschmidt a fait savoir que le marsouin était désormais tellement menacé d'extinction que le parc national sur la côte du Schleswig-Holstein était urgent. Mais ce n'est que la moitié de la vérité, comme le montre l'interview d'Anja Gallus. Elle est depuis de nombreuses années experte en marsouins au musée maritime de Stralsund. Elle connaît les différences entre les différentes populations de cétacés sur la côte allemande et nous parle des dernières approches de recherche et de protection pour ces animaux.
Madame Gallus, le marsouin commun est présent dans la mer Baltique en deux populations distinctes, l'une dans la partie occidentale de la Baltique, l'autre dans la partie centrale, c'est-à-dire au large du Mecklembourg-Poméranie occidentale, de Bornholm et de la Suède. Cette dernière est considérée comme si petite qu'elle est depuis longtemps menacée d'extinction. Combien d'animaux y a-t-il encore et comment sont-ils comptés ?
La dernière fois qu'un recensement acoustique a été effectué dans la partie centrale de la mer Baltique, c'était il y a dix ans. Pour ce faire, tous les pays riverains de la Baltique, à l'exception de la Russie, ont installé des microphones sous-marins dans une grille de recherche sur 305 positions de mesure pendant deux ans. Il en est résulté que nous avons environ 600 animaux dans la partie centrale de la Baltique. Ces animaux sont toutefois différents de ceux qui vivent dans les Belts, que les plaisanciers rencontrent surtout au large des côtes allemandes.
Cela semble étonnamment simple et précis. Est-ce la percée vers des chiffres exacts sur les stocks ?
Eh bien, ce n'est pas si simple. Nous devons d'abord acquérir de l'expérience : Combien de fois par jour un marsouin fait-il de l'écho ? À quelle profondeur le fait-il ? Jusqu'où le signal est-il porté sous l'eau ? Quelle est la taille du groupe qui chasse à cet endroit ? Quelle est la fiabilité de l'appareil de mesure pour capter le signal ? C'est un processus d'apprentissage pour tirer des conclusions sur le nombre réel d'animaux présents. En tout cas, nous allons répéter le comptage cet été pendant un an, presque exactement comme à l'époque, afin d'avoir une vraie comparaison. Le tout doit être évalué au niveau international, car le marsouin est une espèce migratrice, les frontières nationales ne jouent aucun rôle pour les animaux.
Y a-t-il aussi des recensements pour la partie ouest ?
Oui, le dernier recensement de 2022 a donné 14 400 individus pour la mer de Belt et la mer Baltique occidentale. C'est malheureusement environ 3.000 animaux de moins que lors du dernier recensement, qui était déjà plus bas que le précédent. Dans la Baltique occidentale ainsi que dans le Belten et le Sund, le comptage se fait toutefois par avion. Cette méthode a également été tentée autrefois à l'est de Rügen. Des comptages aériens ont été effectués au début des années 90 dans le centre de la Baltique, entre Rügen et Bornholm. Il y a eu trois observations. On a ensuite extrapolé ces chiffres à l'immense zone de la Baltique centrale. On est ainsi arrivé à environ 1900 animaux. Selon le budget, on répète l'opération une fois par an ou tous les deux ans. Si l'on vole et que l'on ne voit pas d'animaux, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y en a pas. Parfois, le soleil est trop réfléchissant, parfois l'eau est trop trouble, parfois les animaux sont tout simplement ailleurs parce qu'ils ont suivi un banc de harengs. Et bien sûr, les animaux se déplacent aussi. En été, ils continuent à migrer vers le centre de la Baltique, parfois jusqu'au Mecklembourg-Poméranie occidentale, et en hiver, ils se retirent dans la mer Baltique. Le recul des comptages aériens dans l'ouest de la Baltique est également en contradiction avec nos mesures acoustiques, qui ont montré une augmentation des signaux acoustiques des marsouins. Nous ne savons pas encore exactement comment expliquer cette contradiction. Les marsouins de l'ouest de la Baltique se déplacent-ils peut-être plus loin qu'auparavant ? Dans la mer du Nord, il y a toujours des déplacements significatifs des populations, actuellement en direction de la Manche. Nous savons tout simplement peu de choses sur le comportement migratoire des animaux. Ou doivent-ils tout simplement se mettre plus souvent à l'écoute de la nourriture parce qu'elle est plus difficile à trouver ? Et bien sûr, le comptage en vol est moins précis que la mesure des sons réellement émis, car les microphones mesurent 24 heures sur 24. Mais le comptage en vol est moins compliqué et moins cher : trois personnes sont à bord pendant une journée, elles comptent les animaux observés, le nombre est extrapolé et c'est terminé. Avec la méthode acoustique, les appareils sont contrôlés tout au long de l'année, des bateaux doivent sortir avec un équipage pour déployer et récupérer l'équipement. Les frais de matériel s'ajoutent également à cela.
Ils disent qu'il est impossible de distinguer si un animal ou des groupes envoient des signaux. En fait, dans quels grands groupes se trouvent les marsouins ?
Souvent, les animaux se déplacent en couple mère-veau, parfois le veau de l'année précédente est encore présent. Mais souvent, ils sont seuls. Les jeunes animaux, qui n'ont pas atteint la maturité sexuelle, se réunissent en revanche plus souvent en petit groupe, peut-être cinq baleines. Même s'il y a beaucoup de nourriture disponible sur place, plusieurs animaux se réunissent. Mais ils ne se réunissent pas régulièrement en groupes aussi importants que ceux que l'on connaît chez les dauphins ou les orques.
En 2007, YACHT avait déjà réalisé une interview avec un éminent chercheur sur les marsouins. À l'époque, il avait également chiffré la population dans la partie centrale de la mer Baltique à 600 individus. La population est-elle plus stable que prévu ?
Le problème, c'est que les deux méthodes ne donnent pas des chiffres totalement exacts. Nous devons absolument améliorer cela. Un exemple pour expliquer pourquoi : dans la baie de Californie, il existe un congénère du marsouin, la vaquita. Lors d'un recensement il y a une dizaine d'années, la population était de plusieurs centaines d'individus. Mais comme les conditions étaient mauvaises pour les animaux, la population a diminué de moitié à chaque recensement, et lors du dernier, on n'en trouvait plus que dix. L'extinction de cette espèce est donc très, très probable d'ici quelques années. Le marsouin de la mer Baltique centrale sera alors le prochain congénère sur la liste.
900 marsouins meurent chaque année dans des filets fixes au Danemark et en Suède
Quels sont donc les principaux problèmes rencontrés par le marsouin dans la mer Baltique ?
Il s'agit en premier lieu des filets de pêche. Ils sont si fins qu'ils ne réfléchissent pas les échos, les baleines ne peuvent donc pas les "voir" ou plus exactement les entendre. Elles nagent dedans, se font prendre et ne peuvent plus remonter à la surface pour respirer, elles meurent donc d'asphyxie.
N'y a-t-il pas eu une initiative visant à équiper tous ces filets de pingers pour avertir les baleines de leur présence ?
Il existe une initiative du Land de Schleswig Holstein qui accorde aux pêcheurs des avantages en contrepartie de l'utilisation de ces pingers : ils peuvent pêcher plus longtemps que d'habitude et poser des filets plus longs. Des milliers de pingers sont certes déjà utilisés, mais ils ne couvrent pas l'ensemble des côtes allemandes ou danoises.
Est-ce qu'elles fonctionnent bien ? Dans ce cas, ce serait une bonne idée de les rendre tout simplement obligatoires.
Jusqu'à présent, il s'agit d'un modèle d'incitation : ceux qui installent les pingers se voient accorder des avantages. Mais les appareils ne sont pas aussi simples que tout le monde l'imagine. La première génération a par exemple fait en sorte de décourager les marsouins, mais d'attirer les phoques. Ils ont appris à un moment donné que là où se trouve le bruit, il y a un filet dormant. Ils ont alors nagé vers les filets et ont très habilement dévoré les poissons dans le filet sans se faire prendre. Pas de problème pour les phoques. C'était à nouveau contre-productif pour les pêcheurs. Il existe maintenant de nouveaux systèmes, appelés PAL, "Porpoise Alert Sysstems". Ils émettent un signal enregistré d'une femelle marsouin, qui avertit du danger. Le fabricant dit que cela fonctionne très bien. Mais il y a aussi des rapports en provenance d'Islande selon lesquels, au contraire, davantage de marsouins ont été capturés accidentellement, et uniquement des mâles. Nous en savons tout simplement trop peu sur la communication des marsouins, qui n'a guère été étudiée. C'est pourquoi on ne peut pas dire si les PAL résolvent vraiment le problème à long terme ou si les animaux s'y habituent par exemple dans trois ans et que les appareils ne servent alors plus à rien. A cela s'ajoute le fait que les différentes populations de marsouins ont éventuellement leur propre "dialecte". Celles du centre de la Baltique sont différentes de celles de l'ouest de la Baltique et probablement aussi de celles au large de l'Islande. Nous travaillons actuellement sur une étude qui s'est penchée précisément sur ce genre de questions, les résultats seront disponibles l'année prochaine.
Lorsque cela a été connu il y a des années, il y a eu une thèse selon laquelle les deux populations allemandes, très différentes en termes de taille, ne se mélangeraient pas du tout en raison de ces différences, et ne pourraient donc pas se renforcer. Est-ce le cas ?
Nos recherches montrent plutôt que les populations se rendent surtout dans des régions totalement différentes pendant la période de reproduction et ne se mélangent donc tout simplement pas. Les baleines du centre de la Baltique migrent pour cela en été en direction de Gotland, celles de l'ouest de la Baltique restent dans leur région, même dans les Belts, et se déplacent peut-être parfois jusqu'au Mecklembourg-Poméranie occidentale ou à Bornholm. Mais il est vrai que les deux groupes présentent des différences génétiques. Il est possible qu'une sous-espèce propre se développe un jour à partir de ces différences. Mais cela prendrait plutôt des siècles.
Quelle est la distance de migration des marsouins de la population occidentale ?
Il existe quelques études danoises à ce sujet. Ils ont en partie d'autres filets de fond, une sorte de senne ouverte vers le haut, qui font que les animaux sont dirigés vers une chambre dont ils ne peuvent plus sortir, mais ils ne meurent pas parce qu'ils peuvent toujours remonter à la surface pour respirer. De temps en temps, de tels animaux sont sauvés et équipés d'un émetteur avec des ventouses. Celui-ci envoie des données GPS, capte les signaux d'écholocation de l'animal et enregistre le nombre de fois où il essaie d'attraper des poissons. Les femelles avec leurs baleineaux sont plutôt fidèles à leur lieu de naissance, les jeunes marsouins et les mâles ont d'autres zones de migration. Mais on ne le sait pas vraiment.
Un marsouin mange chaque jour dix pour cent de son propre poids
Qu'a-t-on appris d'autre sur les animaux ?
Par exemple, ils attrapent parfois des poissons des centaines de fois par heure, qu'ils n'attrapent évidemment pas tous. Mais un marsouin doit manger chaque jour dix pour cent de son propre poids, ce qui peut représenter 5 à 8 kilos, pour couvrir ses importants besoins énergétiques. Imaginez cela pour un être humain ! On comprend dès lors qu'il est évidemment mauvais que le cétacé soit souvent interrompu ou distrait dans cette chasse.
Quels sont les autres problèmes du marsouin ?
La pollution sonore acoustique. C'est un domaine très varié. Bien sûr, les moteurs des bateaux pourraient être plus silencieux, on travaille d'ailleurs sur des hélices plus silencieuses. Mais on explore aussi intensivement le sol à l'aide de puissants appareils de sonar à la recherche de ressources minérales, on pose des tracés de câbles, on enfonce des fondations pour des éoliennes. Celles-ci sont encore fondées à l'aide de nombreux pieux qui sont enfoncés individuellement et très bruyamment. Cela dure des mois et les travaux se font à plusieurs endroits en même temps. Tout cela se multiplie ensuite. Lorsque les parcs éoliens sont installés, les bateaux de ravitaillement viennent s'y ajouter. Les ferries rapides sont aussi extrêmement bruyants. Mais bien sûr, le marsouin vit quand même là, ils ne peuvent pas l'éviter. Le Kadettrinne est l'une des eaux les plus fréquentées du monde, et pourtant les marsouins y vivent. Ils compensent jusqu'à un certain point. Il y a aussi des gens qui vivent près des routes principales. Mais cela stresse aussi bien les hommes que les animaux. Et le marsouin dépend beaucoup plus de son ouïe que nous, parce qu'il chasse et communique par ce biais. Un exemple : les Danois ont pu prouver à l'aide des émetteurs que les marsouins, lorsqu'un navire bruyant s'approche, plongent profondément vers le fond et y attendent silencieusement son passage. Ensuite, l'animal remonte rapidement à la surface, respire trois fois profondément et attend que son rythme cardiaque, qui a fortement augmenté, se régularise. Si cela se produit souvent, on comprend le stress que cela représente pour les animaux - et que le temps manque alors pour la chasse. Mais les jet-skis ou les bateaux à moteur rapides posent déjà un problème.
Le bruit peut-il mettre la vie en danger ?
Oui, malheureusement. Lorsque, par exemple, des explosions de restes de munitions sont effectuées sur le fond, parce qu'elles ne peuvent plus être récupérées. Ils peuvent entraîner directement des blessures et la mort. Si l'oreille interne est blessée, l'animal n'est plus viable et meurt pratiquement immédiatement. Si elle est endommagée et qu'il devient malentendant, cela affecte l'animal à moyen terme, il ne peut parfois plus chasser de manière optimale et meurt de faim.
Si l'on résume les trois principaux problèmes du marsouin commun, s'agirait-il, dans l'ordre, des filets dérivants, des émissions sonores et ... ?
la disponibilité de la nourriture. La mer Baltique est fortement surpêchée, les stocks diminuent de manière dramatique, les poissons sont de plus en plus petits. Le cabillaud, le maquereau, le hareng - le marsouin doit investir de plus en plus de temps et d'énergie dans la recherche de nourriture. Cela a des conséquences : Une bonne moitié des animaux retrouvés morts en mer Baltique n'ont que deux ou trois ans, ils n'ont donc même pas encore atteint leur maturité sexuelle et n'ont donc pas pu assurer leur descendance.
Est-ce que toutes les tentatives de protection effectuées jusqu'à présent ont alors été totalement infructueuses ?
Eh bien, Le degré de pollution de la mer Baltique s'est par exemple amélioré. Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, elle était parfois si élevée que la fertilité des animaux était réduite.
Les trois grands dangers pour les baleines : filets dérivants, bruit, manque de nourriture
On réclame actuellement de plus grandes zones protégées, comme le parc national du Schleswig-Holstein. Mais on entend souvent dire qu'à l'heure actuelle, même les zones protégées existantes ne sont pas limitées dans leur utilisation de manière à ce que cela profite à la forêt. Que faudrait-il donc faire pour que les choses s'améliorent sensiblement ?
C'est le problème des "paper parks". Ils ont été créés parce que l'UE l'exige et que l'Allemagne a dû s'y conformer. Il existe par exemple de grandes zones protégées autour de Fehmarn, dans le Kadettrinne ou dans la baie de Poméranie. Elles ne sont pas explicitement réservées aux baleines, elles protègent parfois aussi des récifs ou des populations d'oiseaux importantes. Le problème est souvent qu'il n'y a aucune restriction pour la pêche dans ces zones. Il devrait y avoir de plus grandes surfaces sans filets dormants ou enfin des méthodes de pêche moins dangereuses pour les baleines, des nasses par exemple. Cela aiderait. L'institut Thünen de Rostock mène actuellement des recherches dans ce sens. Il développe un engin de pêche qui ne met pas en danger les oiseaux de mer et les baleines et qui fonctionne néanmoins pour le poisson cible souhaité.
Ce qui a été surprenant, c'est que le ministère de l'Environnement du Schleswig-Holstein a récemment annoncé que le marsouin commun de la mer Baltique centrale était désormais considéré comme étant en danger d'extinction et qu'il fallait donc agir, et qu'il voulait ainsi faire avancer le parc national de la mer Baltique dans le Schleswig-Holstein. À ma connaissance, l'animal était déjà classé depuis des années, et en outre, la population ne vit pas du tout au large des côtes du Schleswig-Holstein ?
C'est un peu difficile à faire comprendre au commun des mortels, parce que l'espèce n'a été définie comme une population à part entière à l'Est que grâce aux résultats des recherches les plus récentes. Avant, il s'agissait d'une sous-population. Mais c'est vrai, le marsouin commun était déjà considéré comme une espèce en danger d'extinction dans le centre de la mer Baltique.
D'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, le trafic de bateaux des plaisanciers n'est pas du tout le problème des marsouins.
Il y a une très grande différence entre parler des voiliers et des bateaux à moteur. Nous avons également un programme dans lequel nous enregistrons les observations et les rencontres entre les skippers et les marsouins (www.schweinswalsichtungen.de). Nous voyons régulièrement des marsouins accompagner des voiliers sous voile, voire sauter dans la vague d'étrave, plonger dans le sillage, parfois pendant une demi-heure ou plus. C'est extrêmement rare pour les bateaux à moteur. Quiconque a mis la tête sous l'eau en nageant au passage d'un bateau à moteur sait pourquoi - et les marsouins ont une ouïe beaucoup, beaucoup plus sensible que la nôtre.
Dans ce cas, les limitations de vitesse ne sont-elles pas peut-être une solution ?
Bien sûr, nous savons par le trafic automobile à quel point il est plus calme lorsque la vitesse est de 30 au lieu de 50, c'est aussi le cas dans la mer.
Ok, on voit en conclusion qu'une voie rapide vers des améliorations pour le marsouin est complexe. Si vous deviez souhaiter une mesure immédiate qui promettrait probablement le plus grand succès, quelle serait-elle ?
Trouver rapidement des alternatives aux filets de pêche. Beaucoup trop d'animaux y meurent.
Cela pourrait également vous intéresser :
- Entretien avec des biologistes marins : "Un renversement de tendance n'est pas en vue" - la situation de la mer Baltique est aussi mauvaise que cela
- Des dauphins au large de Kiel : surprise pour les jeunes navigateurs à l'entraînement
- Davantage d'espaces protégés : Le parc national arrive-t-il par la petite porte ?

